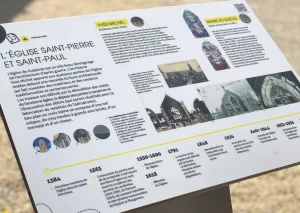
Catégorie : Patrimoine historique
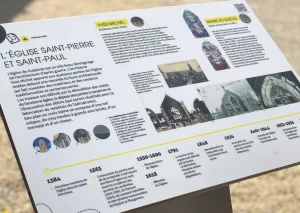

Regards sur le Château du Taureau

Landivisiau

Le Douvez à Guipavas
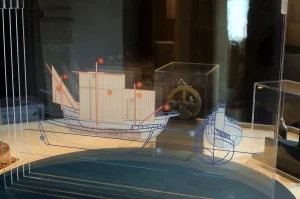
Terre ! Terre ! Les conquêtes européennes au 16e siècle

Ker dreger, le musée des révolutions agricoles
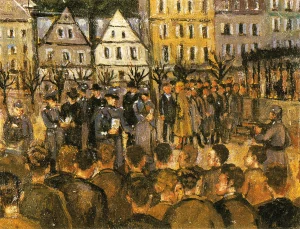
80 ans de la prise d’otages à Morlaix : la peinture comme témoignage

